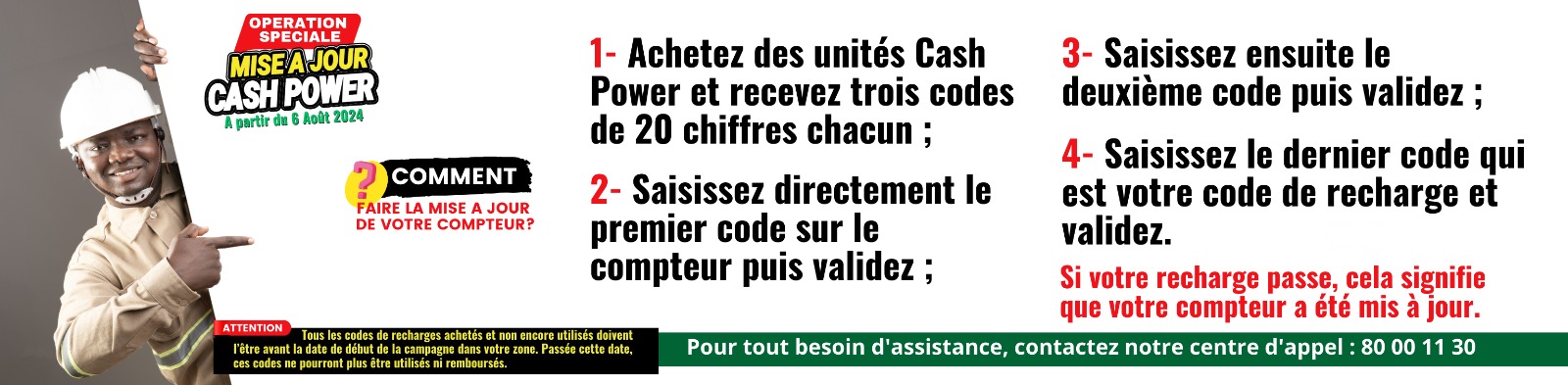« L’éducation est l’arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. » Dixit Nelson Mandela
Le 10 mars 2025, le Gouvernement burkinabè, par un arrêté conjoint du ministre de l’enseignement de base, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales et du ministre de l’Enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique, a institué une coiffure uniforme pour tous les apprenants filles et garçons de certaines structures éducatives. L’article 2 du décret dispose : « La coiffure uniforme des apprenants est faite d’une coupe des cheveux à ras, simple et sans embellissement ni fantaisies quelconques. Toutefois, les tresses et les nattes de cheveux naturels et assimilées sont autorisées pour les filles ».
Le Burkina Faso rejoint ainsi, les États tels que l’Afrique du Sud, le Bénin, le Burundi, le Cameroun et la Côte d’Ivoire où les élèves étaient déjà soumis à cette mesure. Cependant, cette décision du gouvernement burkinabè fait-elle l’unanimité au sein de la population et particulièrement les destinataires ? Sans vouloir y apporter une réponse dans l’immédiat, la présente chronique s’attèlera à relever la corrélation entre l’institution d’une coiffure uniforme au sein des établissements scolaire et le respect des droits de l’enfant.
Mais avant tout propos, il serait judicieux de donner un contenu au concept enfant et droits de l’enfant avant de revenir à la corrélation entre le décret et le respect des droits de l’enfant.
A priori, l’institution de la coiffure uniforme, comme toute nouvelle mesure, apporte des modifications à la jouissance de droits individuels. En l’espèce, il s’agit des élèves et des apprenants qui pour la majorité sont des enfants. En effet, l’article 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1989, le définit comme “tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation applicable”. Qu’en est-il du concept des droits de l’enfant ?
Les droits de l’enfant sont assis sur quatre principes fondamentaux qui sont :
– la non-discrimination : tous les enfants, sans distinction d’origine, de sexe, de religion ou de situation sociale, ont les mêmes droits.
– l’intérêt supérieur de l’enfant : toute décision ou action concernant un enfant doit viser son bien-être.
– le droit à la vie, à la survie et au développement : l’enfant a droit à un environnement qui lui permette de se développer pleinement.
– le respect des opinions de l’enfant : l’enfant a le droit d’exprimer ses opinions et d’être entendu dans les décisions qui le concernent.
Les droits de l’enfant se subdivisent ainsi qu’il suit :
– droits à la protection : protection contre la maltraitance, l’exploitation, le travail des enfants, la guerre, et toute forme de violence (Articles 19, 32), protection spéciale pour les enfants réfugiés, handicapés ou vulnérables (Articles 22, 23) ;
– droits à la survie et au développement : droit à un niveau de vie adéquat, accès à la santé, à une alimentation suffisante, à un logement décent, droit à l’éducation (Articles 24-28) et à des activités culturelles (Article 31) ;
– droits civils et libertés : droit à un nom, à une nationalité et à une identité (Articles 7-8), à la liberté d’expression, de pensée, de religion et de réunion pacifique (Articles 13-15) ;
– droits à la participation : droit de participer activement à la vie de la société (Article 12), droit d’être consulté sur des questions qui affectent leur vie (Articles 12, 14) .
Après ces définitions, nous aborderons la corrélation entre le décret conjoint du 10 mars 2025 et les droits de l’enfant dans la prochaine chronique.
“Nous ne pouvons pas changer tout le système, mais nous pouvons commencer par de petites actions au niveau local”
Aïcha OUEDRAOGO/ZAMPALEGRE
Juriste, Administrateur parlementaire
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon