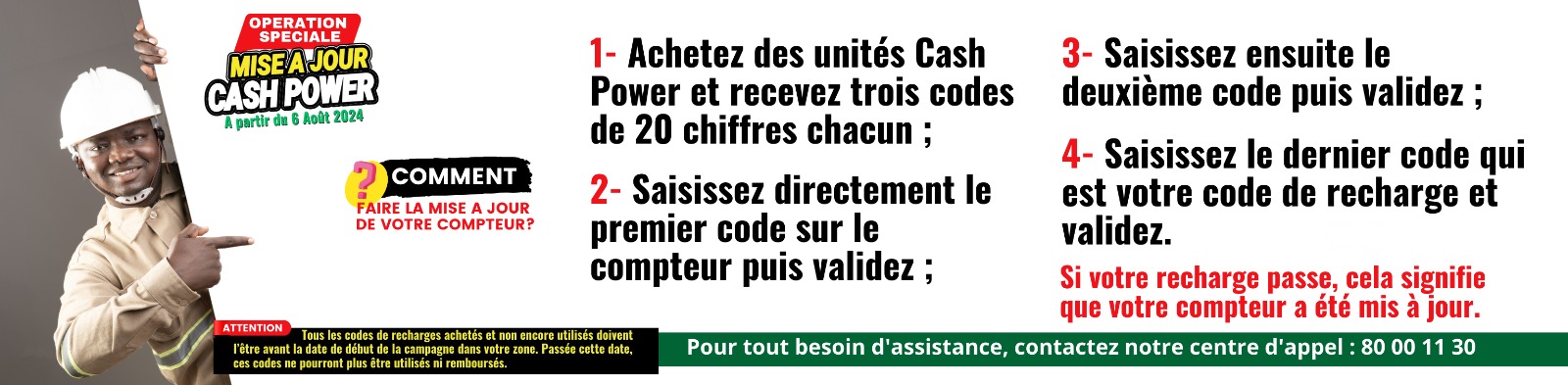Alors que nous revenons sur l’avènement de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), adoptée le 10 décembre 1948, son ambition de marquer une rupture avec les atrocités des deux guerres mondiales et d’établir une norme internationale garantissant la dignité, la liberté et l’égalité pour tous semble aujourd’hui mise à l’épreuve.

En effet, plus de 75 ans après son adoption, la communauté internationale est toujours confrontée à des violations massives et répétées des droits fondamentaux, comme en témoigne la situation dramatique en République Démocratique du Congo (RDC). Le pays est en proie à :
- des massacres de populations civiles,
- l’utilisation du viol comme arme de guerre,
- le recrutement forcé d’enfants soldats,
- des déplacements massifs de populations fuyant les violences.
Face à cette crise humanitaire, la passivité des gouvernements et des institutions internationales soulève des interrogations et sans une volonté politique forte, tant au niveau national qu’international, et risque de compromettre les avancées en matière de protection des droits humains. Comme le souligne avec force Denis Mukwege, Prix Nobel de la Paix 2018 « Le Congo n’a pas besoin de charité, il a besoin de justice. »
Mais comment en était-on arrivé à l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme ?
L’idée des droits fondamentaux s’est inscrite dans une longue trajectoire historique, marquée par des avancées progressives. Dès le XIIIᵉ siècle, la Magna Carta (1215) en Angleterre limite pour la première fois le pouvoir royal et accorde certains droits aux citoyens. Puis, au XVIIᵉ siècle, le Bill of Rights (1689) et les théories de John Locke établissent les premières bases de la protection des libertés individuelles.
Le Siècle des Lumières approfondit ces réflexions à travers Montesquieu, Rousseau et Voltaire, qui théorisent les notions de liberté, d’égalité et du contrat social. Ces idées influencent directement les Révolutions américaine (1776) et française (1789), aboutissant à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) en France.
Cependant, cette première reconnaissance des droits universels présente une limite majeure. Elle ne concerne qu’une partie de la population, les hommes, citoyens et propriétaires, les femmes, les esclaves et les populations colonisées en sont exclus.
Une vision que Thomas Paine dénonce en 1792 dans Les Droits de l’Homme, affirmant la nécessité d’une véritable universalité des droits. Mais il faudra attendre le XIXᵉ siècle pour que ces principes soient revendiqués par de nouveaux mouvements sociaux. Effectivement, l’échec de la Révolution française ne signe pas la fin du combat pour les droits humains. Au contraire, les revendications s’intensifient sous différentes formes :
- les luttes ouvrières et socialistes dénoncent l’exploitation des travailleurs et exigent des droits économiques et sociaux ;
- les mouvements abolitionnistes et féministes contestent l’exclusion des esclaves et des femmes du champ des droits humains ;
- les luttes anticolonialistes remettent en cause l’universalité des droits dans un contexte où les puissances européennes justifient la colonisation sous prétexte d’une mission civilisatrice.
Si ces combats contribuent à élargir la notion de droits fondamentaux, ils restent toutefois insuffisants face aux catastrophes du XXᵉ siècle, qui vont profondément bouleverser la conception des droits humains.
L’évolution des droits humains est mise à rude épreuve par les deux Guerres mondiales, qui causent plus de 60 millions de morts et révèlent l’ampleur de la barbarie humaine. Face à ces horreurs, la nécessité de protéger les droits humains à l’échelle internationale devient une priorité absolue.
Dès 1945, la création de l’Organisation des Nations Unies (ONU) répond à cette volonté d’empêcher que de telles atrocités ne se reproduisent. C’est dans ce contexte que, trois ans plus tard, la communauté internationale adopte la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH). Le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale de l’ONU adopte la Déclaration universelle des droits de l’homme, affirmant le caractère inaliénable et universel des droits fondamentaux.
Son adoption marque une avancée majeure, mais son application reste encore aujourd’hui fragile et incomplète, comme en témoigne la situation en RDC et dans d’autres régions du monde.
Alors que la DUDH devait garantir un monde plus juste et équitable, l’actualité nous rappelle que les droits humains ne sont pas acquis une fois pour toutes. Le conflit en RDC, les violations des droits dans d’autres zones de guerre et la montée des régimes autoritaires interrogent sur la capacité réelle des États à respecter ces engagements. Comme le rappelait Nelson Mandela : « Les droits de l’homme sont la base de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Les nier, c’est ouvrir la porte à l’oppression et à l’injustice ».
Si la Déclaration universelle des droits de l’homme a posé un cadre juridique universel, son application dépend de la volonté politique et des actions concrètes des États et des organisations internationales.
“Nous ne pouvons pas changer tout le système, mais nous pouvons commencer par de petites actions au niveau local”
Aïcha OUEDRAOGO/ZAMPALEGRE